
À l’occasion de sa diffusion sur Arte retour sur Stalag 17, pas le plus célèbre des films de Billy Wilder mais pas le moins savoureux, grâce à son humour et son cynisme.
Le meilleur de Stalag 17, c’est William Holden. Billy Wilder l’avait dirigé trois ans plus tôt dans Boulevard du crépuscule et il appréciait ses zones d’ombre, son ambiguïté. Quand le cinéaste avait décidé d’adapter ce succès de Broadway, une tragi-comédie située dans un camp de prisonniers pendant la seconde guerre mondiale, histoire de se refaire après l’échec commercial cuisant du Gouffre aux chimères, la Paramount lui avait suggéré Charlton Heston. Mais Wilder le trouvait décidément trop héroïque.
Parmi des prisonniers d’opérette, dans une atmosphère plutôt joyeuse, le personnage que joue Holden est celui qui apporte un certain réalisme : apparemment peu réceptif aux joies et peines collectives de ses voisins de chambrée, il trace sa route seul, améliorant son quotidien à coup de petits trafics avec tous ceux qui veulent commercer avec lui, prisonniers, gardiens, etc. Un as du marché noir, un égoïste pas trop sympathique, peut-être même est-ce lui l’espion qui informe les geôliers nazis des tentatives d’évasion lesquelles, de fait, ratent les unes après les autres… Holden est parfait d’amertume et d’ironie – on dirait presque l’un des héros de MASH…
A l’origine, donc, une pièce de théâtre, inspirée des propres souvenirs de POW (prisoners of war ou prisonniers de guerre) de ses deux auteurs, Donald Bevan et Edmund Trzcinski (on aperçoit brièvement à l’écran le second, en train de laver ses chaussettes dans la soupe qu’il vient de servir au baraquement). Épaulé par un scénariste, Edwin Blume, qui se plaignit de n’être qu’un faire-valoir (mais corrigeait peut-être l’anglais encore très viennois du cinéaste…), Wilder la réécrivit considérablement au point que Trzcinski cessa de lui adresser la parole à l’issue du tournage au printemps 1952. Vingt ans plus tard, les auteurs de la pièce attaquèrent en vain les producteurs de la série Stalag 13 (ou Papa Schultz) pour plagiat.
Le film marche sur deux pieds : la vie quotidienne pour rire des prisonniers, la recherche plus dramatique de l’espion parmi eux. Wilder fait vivre avec énergie et humour ces hommes entre eux, animés par un formidable esprit de survie, mais en manque de tout, nourriture, lessive, femmes etc. D’ailleurs, la Paramount voyait d’un mauvais œil ces personnages traînant en sous-vêtements aux taches douteuses, tandis qu’à la lecture du scénario ces messieurs de la censure pointèrent la scène où les deux seconds rôles comiques, directement issus de la pièce, Shapiro et Kuzawa, dansent un slow lascif, le premier déguisé en Betty Grable (la figure de l’homme habillé en femme et pourtant désirable inspirera encore Wilder quelques années plus tard…). Le cinéaste ne céda sur rien, convaincu à juste titre de la puissance singulière de la scène (qui peut rappeler le travestissement, nettement plus soigné, des soldats anglais dans La Grande Illusion).
Autre idée savoureuse de Billy Wilder, la présence de son collègue Otto Preminger, autrichien comme lui, dans le rôle du chef de camp, officier nazi inflexible et un peu ridicule – plus sympathique, selon certains témoignages, que Preminger sur ses propres tournages. Dans son livre de conversations avec Cameron Crowe, Billy Wilder se souvient avec affection d’un gag que trop peu de gens selon lui avaient remarqué : avant de téléphoner à un supérieur, l’officier joué par Preminger prend soin de remettre ses bottes pour pouvoir mieux claquer des talons à chaque ordre reçu, puis une fois l’appareil raccroché demande à son ordonnance de les lui retirer…
Au printemps 1953, Stalag 17 fut un gros succès commercial, rattrapant les pertes du film précédent et recevant un bel accueil critique. Ainsi que l’écrit le New York Times : « La principale réussite de ces révisions [apportées à la pièce] réside dans le personnage joué par M. Holden. Ici, ce n’est pas un type agréable ; il est strictement au service de lui-même. Il fume des cigares, gratte des allumettes sur les vêtements d’autrui et fait preuve d’un sens aigu de l’acquisition. Il prend des paris contre ses propres compagnons et exploite une piste de course improvisée et un alambic à whisky. Mais il a du culot, de l’ingéniosité et un certain courage. » Le film valut au comédien l’Oscar du meilleur acteur, qu’il accepta avec une certaine retenue, affirmant que parmi ses collègues nommés Burt Lancaster ou Montgomery Clift, tous les deux pour Tant qu’il y aura des hommes, l’auraient davantage mérité. À ses yeux, la statuette récompensait avec retard sa prestation dans Boulevard du crépuscule…
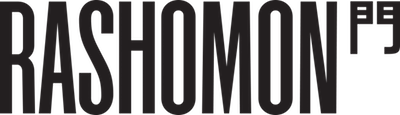





Leave A Comment