
Deux excellents films noirs, singuliers et plutôt rares, en accès libre sur le site d’Arte, ça ne se rate pas.
Je ne sais pas s’il existe une définition concise du « film noir », avec son cortège de flics magouilleurs, de détectives privés fouineurs, de femmes plus belles que la nuit détournant du droit chemin d’honnêtes et diurnes citoyens… Le terme est une invention de la critique française de l’après-guerre et il englobe tout un tas de « films criminels » à l’atmosphère poisseuse et au dénouement souvent tragique. Il trouve son origine dans la maîtrise artistique du cinéma allemand des années trente, ses jeux de lumières et d’ombres, notamment, et ce sont beaucoup les exilés, fuyant l’Europe des pogroms ou du nazisme qui en firent un genre hollywoodien majeur. Bertrand Tavernier parlait d’une esthétique du doute s’opposant à un goût très américain de l’affirmation de soi et du monde. Ce doute suggère que le monde n’est pas tout à fait celui auquel on croit, il trouble la vision, fait apparaître les choses derrière les choses.

C’est exactement ce qui se joue, et même au centuple, dans L’Évadée (1946, en anglais The Chase, la poursuite) qu’Arte offre en accès libre sur son site jusqu’au 1er avril. Le film est signé Arthur Ripley, cinéaste dont je ne sais presque rien mais dont j’apprends, grâce à Bertrand Tavernier toujours (dans 50 ans de cinéma américain) qu’il fut un gagman pour Harry Langdon avant de devenir un metteur en scène étrange, ce que je veux bien croire à la vision de cette extravagance baroquissime. Un Américain moyen, ancien soldat récemment démobilisé et désargenté, s’acoquine presque sans le savoir avec un mafieux hyper violent (on le voit gifler jusqu’au sang une manucure maladroite) et accepte d’exfiltrer sa jeune épouse (Michèle Morgan, dans un anglais parfait) qui n’en peut plus de ruminer son malheur de l’avoir épousé.

Le film est bourré de détails insolites, du décor de palais dans lequel vit le malfrat jusqu’à l’étrange double commande qu’il a installée dans sa voiture et qui lui permet depuis le siège arrière d’accélérer ou (plus rarement) de freiner à la place son chauffeur. Plus étrange encore, un twist narratif abracadabrantesque alors que les fuyards ont réussi à gagner La Havane, vue comme une ville labyrinthique et cauchemardesque, égare le spectateur et modifie profondément l’intrigue (changement imposé par la censure, si j’ai bien compris). De quoi en faire un drôle de film halluciné. J’allais oublier Peter Lorre, inestimable second rôle inquiétant aux yeux exorbités – le film est produit par Seymour Nebenzal, à qui l’on doit, avant son départ d’Allemagne, M le maudit.
Autre cadeau, au même endroit : Pitfall, d’André de Toth (1948). Pitfall ou le piège dans lequel tombe presque à dessein un agent d’assurances américain joué par Dick Powell, au contact d’une femme presque fatale, ou peut-être fatale malgré elle, qui a les traits de Lizabeth Scott, la blonde aux sourcils bruns. On est au cœur de la thématique des films noirs, un individu lambda embarqué dans une affaire qui le dépasse vite, mais de Toth bannit la plupart de la mythologie qui va avec, s’acharnant à un réalisme inattendu, servi par les dialogues adultes et modernes d’un certain William Bowers, qui ne sera pas crédité au générique.
La mise en scène de de Toth est tout entière consacrée à l’opposition entre l’espace domestique, confortable mais aliénant, et ce qui pourrait venir le troubler, un extérieur de passion et de danger. Pestant contre sa routine familiale et son travail répétitif, le héros du film se jette à corps perdu dans une aventure trop grande pour lui (on pense parfois au génial Dangereuse soue tous rapports de Jonathan Demme), et les échanges, jamais moralisateurs, entre Dick Powell et Jane Wyatt, qui joue sa femme, sont étonnants de lucidité, voire d’amertume.
De l’autre côté, il y a de quoi être attiré par la jeune mannequin aux mauvaises fréquentations que joue Scott, à la fois désarmante et ambiguë ; et de quoi avoir peur du privé qui lui tourne autour, le massif et inquiétant Raymond Burr (futur Homme de fer à la télévision), une sacrée masse – on dirait qu’il porte les costards oversize de David Byrne dans Stop making sense. Cette fable grinçante sur les choix de vie et leurs conséquences et bouclées en moins de 90 minutes, prenez-en de la graine cinéastes d’aujourd’hui. Attention, Arte essaie de vendre comme un film noir L’Emprise de John Cromwell, alors qu’il s’agit d’une adaptation inégale de Servitude humaine de Somerset Maugham, plutôt du côté du mélodrame, avec une très jeune Bette Davis en croqueuse d’hommes à l’accent cockney. Je suppose que ces trois films, très tôt tombés dans le domaine public, ont en commun d’avoir fait partie d’un lot acheté au distributeur américain Kino Lorber (la copie du Cromwell est limite).
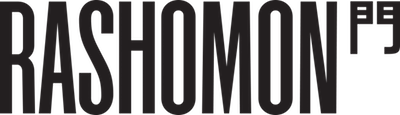





Leave A Comment