
ALAIN LE DIBERDER, ancien de Canal+, France Télévisions et Arte, observateur attentif des évolutions des industries audiovisuelles, ALAIN LE DIBERDER, ancien de Canal+, France Télévisions et Arte, a récemment mis en ligne une étude sur l’âge du public et la mainmise de Disney. Rashomon lui a posé quelques questions sur le cinéma en salles et l’arrivée des plateformes.
Le public des salles de cinéma a-t-il vieilli ?
ALAIN LE DIBERDER : C’est un fait que l’on constate un peu partout depuis une dizaine d’années, singulièrement aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France : un vieillissement lent mais constant du public. En France, en dix ans, 20 millions d’entrées de « jeunes » ont été remplacées par 20 millions de « seniors ». Ce vieillissement est plus rapide que l’évolution démographique. Selon les pays, les professionnels ne réagissent pas de la même façon. Aux Etats-Unis, comme le box-office est mesuré en dollars, une augmentation régulière du prix du ticket masque la baisse des entrées. De toute façon, les salles de cinéma vivent d’abord de la confiserie. Ce qui les intéresse, c’est la dépense finale du consommateur et pas seulement le ticket. Les Anglais sont beaucoup plus inquiets : plusieurs études ont montré qu’il y avait deux facteurs de désaffection des salles par les jeunes. D’abord, le prix, notamment à Londres. Ensuite, la situation décrite par cette affirmation : « je voudrais bien aller voir ce film mais je ne trouve pas de pote pour m’y accompagner ». Il ne s’agit plus de persuader un individu X de voir un film mais le pote d’un individu X…Le marketing des salles pour les jeunes doit passer par les réseaux sociaux et non plus les télés, les affiches, etc.
Et en France ?
ALAIN LE DIBERDER : C’est un peu l’omerta. Tout le monde est au courant. Il y a des études qui montrent cette évolution, mais à ma connaissance pas d’analyse qui en pointe les causes. Si l’on croise ce phénomène avec la concentration des entrées sur les films de licence type Marvel, Pixar, etc, qui sont, eux, destinés au public jeune, il y a une matrice infernale : les jeunes vont voir des films de licence et presque pas les autres. Et le cinéma d’auteur est vu par les plus de 50 ans. Les jeunes cinéastes, par exemple les réalisateurs d’Atlantique ou des Misérables, s’adressent en fait aux plus de 50 ans et ne le savent pas…
Dans un colloque récent, la productrice Sylvie Pialat disait : « notre public sera bientôt au cimetière ». Le milieu découvre qu’en fait il s’adresse aux seniors… Bon, au fond, ce n’est pas grave, les entrées se font quand même et c’est un peu comme les Etats-Unis : les salles – surtout les multiplexes – gagnent de l’argent par la confiserie, le hors-cinéma, les locations, etc. C’est grave quand les cinéastes s’endorment le soir. Ils sont déçus : ils ont une représentation du public qui n’est pas celle donnée par les statistiques.
Proposer des films d’auteur à un public moins âgé, c’est compliqué ?
ALAIN LE DIBERDER : Le distributeur veut que son film soit en salle longtemps et qu’il trouve un public : l’âge des spectateurs, il s’en fiche un peu. Quand on lui demande de cibler, il est embêté, ça ne recoupe pas forcément le intentions de l’auteur, et il ne sait pas bien comment s’y prendre. Les distributeurs sont des boites « b to b » (business to business), leur marché, ce n’est pas le public final, ce sont les exploitants. Pour toucher les jeunes, il faudrait faire du « b to c » (business to consumer), a fortiori dans une époque de désintermédiation.
Je pense qu’il faut se résigner à ce que cette tendance démographique continue. La consommation par les jeunes de la télévision, de la radio, de la presse écrite baisse. Idem pour leur fréquentation des salles de cinéma. Au moins, pour ce qui est du cinéma, cette chute est-elle compensée par des spectateurs âgés. On sait que quelqu’un de 20 ans qui ne regarde pas la télévision linéaire ne la regardera jamais. Côté cinéma, dès les années 90, on a noté une courbe en U : aller au cinéma quand on est jeune, ensuite, premier travail, premier enfant, on n’a plus le temps ; et à la retraite, retrouver ce plaisir, et même se sentir rajeunir grâce au cinéma.
Vous pointez aussi la domination, voire l’hégémonie Disney…
ALAIN LE DIBERDER : La concentration s’est brutalement accélérée. En 2019 aux Etats-Unis, Disney a obtenu en seulement treize films plus du tiers des entrées totales ! En imposant aux salles un partage des recettes qui leur est très défavorable : Disney prend entre 60 et 70% du prix du ticket. En France, le code du cinéma, qui fait mille pages, encadre le taux de remontée de recettes. Mais si vous programmez La Reine des neiges 2 et que vous voulez une Reine des neiges en plastique à l’entrée de votre cinéma, elle va vous coûter cher. Comme le matériel promo. C’est plus vrai à l’étranger qu’en France, mais Disney est quasiment en mesure de programmer les salles. Ce sont eux qui font le calendrier.

Qui a eu l’intuition de cette montée en puissance ?
ALAIN LE DIBERDER : Bob Iger, qui, sur le plan du business, est un génie. Il prend la direction de Disney en 2005. Avec une idée forte : l’atout d’un film, ce ne sont plus ses stars ou son réalisateur vedette, c’est son titre. Peu importe qui a réalisé Toy story 4, ce qui compte, c’est que le film s’appelle Toy story. Il se débarrasse de Miramax, rachète tour à tour Pixar, Lucasfilms, Marvel, et il diminue la production par deux. Et puis il rachète la Fox. Bien sûr, on peut regretter qu’il ait réussi à ce point-là, mais voilà un type qui a une vision, qui l’applique brutalement et ça marche. Par exemple, et c’est plutôt un mérite, il met fin à la domination des agents, puisqu’il n’a plus besoin des stars. La question, c’est de savoir pourquoi les Américains ont accepté que Disney rachète Fox. En 1940 ou en 1980, ce n’aurait pas été possible ; mais Trump et déjà Obama avant lui ont assoupli les règlementations anti-trust.
Pour le cinéma américain, l’année de rupture, c’est 2009. Plusieurs événements se succèdent, très commentés dans les hautes sphères de majors. Premièrement : 50% des revenus du cinéma américain viennent désormais de l’étranger. Or, qui connait le mieux le marché mondial parmi les majors de l’époque ? Disney. C’est une marque à l’international, alors que Warner, par exemple, hors Etats-Unis, c’est du « b to b ». Qui parmi les spectateurs des Harry Potter sait que ce sont des films Warner ? Ensuite, le dvd s’écroule et Netflix obtient son accord avec Starz. Dans les années 2000, les studios avaient essayé de faire de la s-vod. Mais sans le savoir-faire qu’aura bientôt Netflix. Ils avaient alors cédé les droits s-vod de leurs films à Starz [à l’époque, une chaine payante] qui les a bradés pour 20 millions de dollars à Netflix. La plateforme s’est retrouvée avec 2500 films de majors et a plus que doublé son nombre d’abonnés à cette période.
Revenons en France : quel va être l’impact de l’accord passé par Canal+ avec Disney+, dont le groupe français sera le distributeur exclusif – hors OTT ?
ALAIN LE DIBERDER : Canal+ est en train de faire un virage douloureux et intelligent vers le métier de distributeur. Canalsatellite prend le pouvoir sur canal Plus. A priori, ça n’aidera pas le cinéma français : la contribution est calculée sur la chaine Canal + et elle va continuer à baisser. A une exception près : jusque-là, le cinéma français était une contrainte pour Canal. Ne passer que du foot et des films américains aurait pu suffire, pensaient ses dirigeants… Mais les films américains vont se raréfier : il y aura moins de films Disney quand ils seront sur Disney+, moins de films Warner quand ils seront sur HBO Max, moins de films Universal quand il seront sur Peacock. Le film français va redevenir un atout.

Vous ne paraissez pas inquiet de la crise de financement que traverse le cinéma français avec, notamment, la baisse des contributions des chaînes de télé…
ALAIN LE DIBERDER : Ce n’est jamais bon d’avoir moins d’argent. Mais Vincent Maraval a raison : l’argent qui est venu tout d’un coup dans le cinéma à partir du milieu des années 80 à cause du succès de Canal+ et des contraintes données au chaînes a été purement inflationniste. On n’a pas produit plus de films, ni plus de chefs-d’œuvre – si l’on regarde la décennie 75-85, elle est très brillante. Que s’est-il passé ? L’argent est allé chez les agents. Il faudrait regarder les revenus de Daniel Auteuil en 1986, l’année de Manon des Sources : c’est le début ! Aujourd’hui, Kad Merad, Dany Boon, Jean Dujardin, ces gens sont trop payés. Quand il y aura moins d’argent, ça se dégonflera par là… Il n’y a pas beaucoup d’autres endroits où gratter.
Mais la contribution forcée des chaînes a perdu sa logique alors que le cinéma ne marche plus à la télévision…
ALAIN LE DIBERDER : Ce système n’a jamais été logique et ce n’est pas son but. Quand il se met en place, vers 1988 ou 1989, il y a cinq chaines en France, hors Canal+, qui doivent passer chacune 104 films en prime time, dont 40% de films français. Il n’y a pas de quoi alimenter ce volume de diffusion. La demande croit beaucoup. On oblige les chaînes à dépenser 3,2% de leur chiffre d’affaires, les films sont limités, donc le prix des films monte. Effet inflationniste mécanique.
Mais les gens du cinéma ont voulu que cet argent soit versé principalement en droits d’antenne, totalement disproportionnés avec la valeur économique du film. On mettait 4 millions sur un film qu’une chaine aurait dû acheter 400.000. Ces films n’étaient pas aimés, programmés très tard, et c’était un gâchis. Si les chaines avaient étaient obligés d’investir en part coproduction, elles auraient été intéressés à ce que le film soit bon ! Quitte même à leur interdire de diffuser le film sur lequel elles se sont engagées !
Mais les producteurs voulaient l’argent de la télé et leur victoire est une victoire à la Pyrrhus, qui a provoqué l’inflation des cachets, l’inflation des devis, la création de fausses stars et leur propre déresponsabilisation. Aujourd’hui, un film c’est une matrice : en ligne, les différents investisseurs, en colonnes, les différents marchés et on met des croix sur la matrice. On peut très bien gagner de l’argent sur un échec, et en perdre sur un succès, ça dépend sur quel support vous avez votre couloir de recettes ! Parler de la rentabilité d’un film de façon globale n’a aucun intérêt.

Si Netflix produit des contenus français, cela va-t-il booster la production ?
ALAIN LE DIBERDER : La réponse est clairement non. Il y a plus de trente ans, la directive TSF imposait aux sociétés européennes de ne pas diffuser plus de 50% de programmes américains. Trente après, on en est réduits à demander à des entreprises américaines : s’il vous plait, passez 30% de programmes européens. Tout est dit… Netflix respecte la loi, ouvre un bureau à paris ; au « board », il y a Rodolphe Belmer, ex-Canal+. Mais pour le cinéma français, la contribution ne sera pas la même. Et un jour Canal+ va peut-être demander à laisser tomber sa fréquence hertzienne, pour n’être qu’une plateforme s-vod, dont les films ne passeront plus que sur Canal.
Si, il y a un effet positif. Le cinéma français s’exporte mal. Quand il passe sur les plateformes, il trouve une audience mondiale. L’exposition que donne Netflix, c’est toujours mieux que rien.
Après Netflix, Apple+, Disney+ va être lancé sur le marché français. Suivront sans doute HBO Max et Peacock. A quoi va conduire la multiplication des plateformes ?
ALAIN LE DIBERDER : Il y a deux solutions : soit l’on va un modèle suicidaire d’exclusivité verticale, les films Disney ne passant que sur Disney+, les films Netflix que sur Netflix et ainsi de suite, et il y aura des morts. Parce que, dans un premier temps, c’est moins rentable : quand Disney a cessé de vendre ses contenus aux différentes chaînes pour les garder sur sa plateforme, ça leur a couté beaucoup argent. Avant que Disney+ ne rembourse ces sommes, il faudra du temps. Et ils sont plus solides que les autres majors.
Second scénario : les majors gardent des contenus en exclusivité, mais il y aura aussi du non-exclusif. Le système sera plus stable, et chacun définira sa cible : Disney va occuper le modèle familial, Netflix sera plus généraliste, etc.

Pourquoi n’existe-il pas, hors Mubi, qui reste assez confidentiel, de plateforme plus orientée vers le cinéma d’auteur, ou la cinéphilie classique ?
ALAIN LE DIBERDER : Je suis comme vous, je le souhaiterais. J’y mettrais même plus de dix euros mensuels ! Mais les géants de l’audiovisuel sont possédés par des fonds qui écoutent tous la même musique : dominer le marché mondial, s’adresser au grand public, empiler les films de super-héros, etc. En France, des offres de ce type existent, comme Filmo TV, par exemple. Mais une autre question surgit, la fin du dvd. En 1968, la cinéphilie était moribonde. Le mouvement des ciné-clubs s’était quasiment éteint, les cinémas de quartier disparaissaient, il n’y avait pas encore le Cinéma de Minuit à la télévision. La cinéphilie a ressuscité grâce à la vidéo. La VHS a recréé une génération de cinéphiles. Le dvd qui lui a succédé était un outil formidable, notamment via les bonus. Mais il est en train de mourir parce que de mauvaises fées se sont penchées sur son berceau : on n’a pas lutté contre le piratage, ou alors via ce fameux clip de l’ALPA qui défigurait les dvd légalement achetés, des politiques de prix débiles ont été pratiquées. L’écroulement du dvd crée un vrai problème culturel.
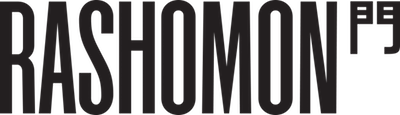


Leave A Comment