
Bertrand Tavernier se souvient du tournage de son quatrième film, Des Enfants gâtés. Et de Christine Pascal, qui en était l’une des interprètes.
Je crois avoir déjà employé l’expression « continent englouti » pour qualifier le cinéma français des années 70. C’est une période passionnante parce qu’on y voit à la fois les expérimentations d’un cinéma d’auteur qui s’affranchit lentement de la Nouvelle Vague et se politise dans le sillage de mai 68, la création de la SRF, etc. ; le maintien d’un cinéma populaire porté par ses stars ; beaucoup d’essais que j’appelle « orphelins », films quasi uniques de cinéastes peu prolixes, etc. Même chez les grands auteurs, l’heure est à l’audace, à des tentatives que la décennie suivante (avec la baisse des entrées, l’apparition de Canal Plus) rendra plus difficiles.
Disponible en ce moment sur Ciné+, Des Enfants gâtés est le quatrième film de Bertrand Tavernier, alors trentenaire : il raconte la lutte de locataires injustement expulsés par un propriétaire grippe-sous. Lutte à laquelle participe un cinéaste, joué par Michel Piccoli, qui a emménagé dans l’immeuble pour écrire un scénario ; s’agrègent plusieurs sous-intrigues : l’émancipation affective et sexuelle d’une vingtenaire, jouée par l’actrice Christine Pascal, le patient travail d’une thérapeute (l’épouse de Piccoli, jouée par la comédienne Arlette Bonnard) auprès d’enfants en détresse psychologique, etc. L’ensemble brosse un portrait esthétique et moral de la France de l’époque. J’ai eu envie de demander à Bertrand Tavernier ses souvenirs du film.
BERTRAND TAVERNIER : “ Je sortais de deux films historiques, j’avais envie d’un sujet contemporain, d’abord parce qu’à chaque fois j’ai envie de changer, et aussi parce que j’en avais marre de cauchemarder sur les antennes de télé, les extérieurs gâchés par les pylônes et les poteaux télégraphiques. Après deux sujets très vastes, j’avais aussi envie de quelque chose d’intime et qui soit proche de moi.
En effet, quand j’habitais Rue des Dames, dans le XVIIème, des locataires et moi étions allés vérifier le compte des charges et avions trouvé des irrégularités. Nous les avons signifiées et nous avons été expulsés. Ainsi, j’ai fondé un comité de locataires… Je me suis dit que c’était un point de départ et qu’il fallait y ajouter un personnage complètement étranger au décor : j’ai pensé à un réalisateur comme Claude Sautet, qui très souvent, louait un studio pour s’isoler, et y travailler avec ses scénaristes, Claude Néron ou Jean-Loup Dabadie.
Je voulais qu’il y ait la même liberté et la même profusion de Que la fête commence, et pas toujours liés à des péripéties fortes. J’étais très influencé à l’époque par la manière dont John Dos Passos casse parfois ses récits : il interrompt la narration principale par ce qu’il appelle « camera obscura », des détails de la vie quotidienne, un article de journal, etc. Je voulais essayer cela, multiplier les échappées du récit : les enfants qu’on essaye de soigner, plus largement la situation urbanistique, des impressions que j’avais de Paris, plutôt négatives et j’avais raison.
A l’époque, c’était le début de cette politique urbanistique qui a consisté à détruire des quartiers populaires. On transformait Paris en une ville de bureaux, dont le premier symbole est l’établissement des tours de la Défense, qui a vidé un quartier de sa vie et de son passé. C’était le début de la spéculation immobilière, c’était la destruction des Halles, l’un des grands crimes urbanistiques commis par Chirac et consorts. Et on est arrivés au Paris d’aujourd’hui, où il n’y a plus d’artisan.
Je voulais raconter cette transformation à travers des gens appartenant une petite classe moyenne, des gens qui ont une forme de confort, ils sont « gâtés » par rapport à d’autres, mais ils sont aussi traités comme des moins que rien. Les locataires n’avaient aucun droit, les lois ont changé cela depuis. On a tourné dans le XVème arrondissement. Autre élément autobiographique : comme Piccoli dans son appartement, j’entendais, Rue des Dames, les messages publicitaires du supermarché voisin. Après deux ans de bataille, ils ont enfin insonorisé !”
Au cœur du film, la performance frémissante et tendue de Christine Pascal, que Bertrand Tavernier avait découverte pendant le casting de l’Horloger de Saint-Paul, une actrice, plus tard une cinéaste, à la fois volontaire et fragile, hantée par des démons intérieurs qui ont fini par avoir raison d’elle. Elle s’est suicidée en 1996 à 42 ans.
BERTRAND TAVERNIER : Il n’y avait rien dans le film qui soit un sujet à la mode, et surtout pas son propos féministe qui n’a pas été commenté, à peine remarqué. Bien que le film eût été voté meilleur film de l’année par les associations féministes de Californie ! Charlotte Dubreuil a écrit la construction de l’histoire et beaucoup autour du personnage de la femme de Piccoli, et Christine s’est emparée avec moi de son propre personnage. Nous avions écrit ce long monologue sur la jouissance et la façon de le porter à l’écran avait été notre seul désaccord. Elle voulait le dire au lit, après avoir fait l’amour avec Piccoli. J’y étais opposé, je lui disais que ça paraîtrait sermonneur, donneur de leçon. Et puis qu’elle serait nue, que les gens seraient plus occupés à la regarder qu’à l’écouter. Longtemps après, elle m’a dit que j’avais eu raison. Christine était parfois crispée sur des idées théoriques, et je devais me battre, elle savait être doctrinaire, sans doute influencée par des gens autour d’elle. Mais elle est d’une modernité incroyable. »
« Entre Piccoli et elle, ça se passait bien pendant les scènes. Hors plateau elle voulait un peu le séduire. Piccoli était quelqu’un d’énigmatique. Je ne l’ai pas trouvé humainement, je n’ai pas su m’y prendre. En revanche dans le travail quotidien, c’était une merveille. Je sortais de rapports d’amitié formidable avec Noiret, Rochefort, etc., et là c’était différent, peut-être que j’en demandais trop, que j’étais trop inquiet. Mais dès que l’on répétait, c’était un acteur inouï. Il y a des acteurs géniaux qui ne sont pas des charmeurs. Gene Hackman est comme ça. Piccoli donnait tout sur le plateau, il respectait ses partenaires. Ça a servi le film parce que Christine est devenue encore plus vibrante et désireuse de le convaincre.
J’avais proposé à Claude Sautet de jouer lui-même le coscénariste, mais il a décliné l’offre. Alors, j’ai demandé à Piccoli : avec quel acteur te sentirais-tu confortable ? il a tout de suite dit Michel Aumont que j’avais vu à la Comédie Française, que j’aimais beaucoup. Je lui ai demandé de jouer Sautet, il en a été très heureux, il jouait ces espèces d’énervement qui naissent de façon surprenante et qui ont l’air de se nourrir d’eux-mêmes.
Les réflexions sur les « clandés » et les putains, c’était plutôt les frères Sarde, Alain dont c’était la première production, et Philippe, le compositeur. Ils avaient cette formule entre eux : « Ce soir, il y a nocturne à la Samaritaine » ! Je suis très fier de la musique du film : j’avais eu l’idée de demander à Sarde un arrangement pour deux saxos et deux contrebasses d’un thème de Marin Marais, la Sonnerie pour Sainte Geneviève du Mont de Paris dont bien plus tard Tous les matins du monde allait faire un tube. A l’époque, la musique baroque n’était pas du tout à la mode. On a eu des pointures : Johnny Griffin et John Surman au saxo, Barry Guy et François Rabbath à la contrebasse. Mais on a plus parlé de la chanson de Sarde et Caussimon, Paris jadis, interprétée par Rochefort et Marielle, qui a été un succès !
On a tourné en 26 jours, on avait peu d’argent. Piccoli, qui était coproducteur, a amené un directeur de production qui a été une merveille, un vieux de la vieille, Louis Wipf, qui avait travaillé sur les films de Clouzot et de Grémillon. Je l’ai repris pour Coup de torchon. Il avait une maîtrise admirable du budget. Cela m’a conforté dans l’idée de travailler avec ces gens que personne ne voulait plus employer et qui étaient pourtant porteurs d’un savoir que n’ont pas les plus jeunes. J’avais commencé avec Aurenche et Bost, après je suis allé chercher Trauner, etc.
Une partie du souvenir un peu déstabilisant, c’est qu’on ne tournait que dans des décors sinistres, enfin disons, pas visuellement transcendant. Je sortais de films avec des extérieurs splendides, ceux du Juge et l’Assassin éclairés par Pierre-William Glenn. Là j’avais des F2, des F4, on était entassés dans des appartements sinistres, au bout d’un moment on n’en pouvait plus.
Glenn n’a pas fait le film parce qu’il était pris et qu’il était assez remonté contre Christine Pascal. Alors j’ai pris Alain Levent, qui avait fait mon sketch de La Chance et l’amour. Je l’avais connu à Rome-Paris Films [la société de production de Georges de Beauregard et Carlo Ponti]. Il n’est jamais crédité pour cela mais c’est lui qui a remplacé Raoul Coutard pour la fameuse scène du Mépris où Bardot demande à Piccoli s’il aime ses fesses ! Il n’avait pas le dynamisme et la drôlerie de Glenn, ce côté bulldozer qui m’aidait beaucoup. Il était plus mesuré : « ouais, ah pas terrible les décors… ». Ça m’avait un peu déstabilisé. Mais Christine Pascal est merveilleusement éclairée. Et là, c’est Levent, il savait photographier les actrices.
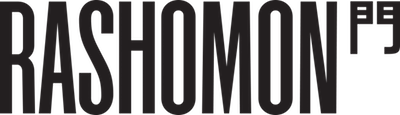


Leave A Comment