
L’INTÉRÊT POUR LES FILMS DE PETER BOGDANOVICH A ÉTÉ RAVIVÉ PAR LA MORT DU CINÉASTE, LE 6 JANVIER. MAIS SES ŒUVRES DES ANNÉES 70 FORMENT UN CONTINENT ENCORE À EXPLORER.
Il paraît que Peter Bogdanovich avait dirigé certaines séquences de Nickelodeon, son film sur les premiers temps du cinéma, perché sur un cheval. Mais pourquoi donc ? lui demandaient ses producteurs en s’arrachant les cheveux devant les caprices à répétition du cinéaste. Parce que John Ford l’avait fait avant lui, répondait-il en se foutant ouvertement d’eux. Son attitude arrogante et provocatrice, celle du type qu’on a tellement encensé quand il était jeune qu’il a intégré une bonne fois pour toutes qu’il est un génie, est typique du « Nouvel Hollywood » dont il est contemporain (premier film en 1968, premières – et seules – nominations à l’Oscar en 1972).
Mais, à l’inverse de certains de ses contemporains, Bogdanovich ne voulait pas déboulonner le vieux système moribond pour imposer des formes nouvelles ; en bon cinéphile ayant interviewé tous les vieux de la vieille, il avait le regard braqué sur l’âge d’or des studios, et l’obsession de ressusciter de genres en déshérence. Peut-être aurait-il aimé être un cinéaste sous contrat, comme avant, mais dont la notoriété et les succès lui auraient permis de faire tourner en bourrique ses commanditaires, voire de les mettre à ses pieds. Au fond, il aurait voulu être Orson Welles, son ami, qu’il hébergea longtemps chez lui (un cliché fameux les montre au supermarché devant un caddy bien rempli), mais un Welles qui aurait réussi à l’intérieur des studios. Il savait pourtant que l’équation était impossible.
Sa carrière a été faite de hauts et de bas, sa vie aussi, la tragédie la plus cruelle étant celle de la mort de Dorothy Stratten, sa compagne, assassinée alors qu’il venait de la diriger dans Et tout le monde riait. Le fait divers sera reconstitué dans Star 80 (et Bogdanovich en voulait à Bob Fosse d’avoir accepté ce projet). Bogdanovich n’est sans doute pas l’égal d’un Coppola ou d’un Scorsese, qui sont ses contemporains, et il n’a sans doute pas réalisé de films aussi marquants que Cimino, né la même année. Mais La Dernière Séance ou La Barbe à Papa sont de vraies réussites, maîtrisées, émouvantes – et qui n’ont guère vieilli puisqu’ils sont tournés « au passé ». J’ai eu envie de revoir les films qu’il tourne dans les années 70, sa décennie de gloire, qui le voir partir de haut pour finir assez bas –, que, personnellement, je trouve un peu surcoté, est son film de convalescence. Surprise, le bilan film à film est sympathique. Enfin l’amour ! aura droit à son post à lui…
On s’fait la valise, docteur ? (1972)
C’est une idée assez folle : ressusciter la « screwball comedy » des années 30. L’intrigue, forcée mais on s’en fiche, est presque littéralement empruntée à L’Impossible Monsieur Bébé, de Hawks : une jeune oisive fofolle (Barbra Streisand, assez irrésistible) met sens dessus dessous un prof de géologie timide et bégayant (Ryan O’Neal, impec aussi) venu avec sa femme et ses cailloux postuler à une bourse. S’ajoutent pléthore de gags visuels, notamment une bataille de tartes à la crème et une poursuite poilante dans les rues de San Francisco, cette fois sous influence Keaton. Le film est visible sur la Cinetek et peut faire un super divertissement pour les enfants.
On raconte que Streisand, déjà star et oscarisée, qui voulait absolument travailler avec le nouveau prodige Bogdanovich, avait détesté le scénario et, sûre de l’échec du projet, revendit son intéressement – 10% du box-office. Quand le film dépassa les 65 millions de dollars de recettes, elle s’en mordit les doigts. On sait que Wes Anderson produisit le dernier film de Bogdanovich, Broadway therapy. Il y a dans la loufoquerie méticuleuse de On s’fait la valise, docteur ? (traduction du cartoonesque What’s up Doc ? qui fait de Streisand un lapin) quelque chose qui rappelle l’art du burlesque symétrique propre à l’auteur de The French Dispatch (lui aussi connaît son vieil Hollywood sur le bout des doigts). La bande-annonce « featurette » ci-dessus est assez amusante.
Daisy Miller (1974)

Plus Baumbach qu’Anderson : aujourd’hui, Greta Gerwig serait l’actrice parfaite pour jouer l’héroïne de ce court roman d’Henry James. Mais Cybill Shepherd fait le job à merveille. On sait que Bogdanovich a « découvert » sur une couverture de Glamour cette splendide beauté du Tennessee, 1,77m de blondeur aux yeux bleus, pour qui il quittera sa première femme, la scénariste-costumière-décoratrice Polly Platt. Après La Dernière Séance, il la dirige dans un rôle plus casse-gueule : celui d’une Américaine coquette, dont l’extravagance et le côté nouveau riche scandalisent la haute société américaine en villégiature en Suisse et en Italie… Daisy Miller parle vite et tout le temps dans une sorte de perpétuel besoin d’exister face à des expat’ cruels qui la rejettent et Shepherd excelle dans le charme et la maladresse – sans compter que sa beauté est renversante. Le film est modeste, ce qui n’est pas une qualité habituelle du travail de Bogdanovich, et il est tourné dans les lieux même mentionnés par le roman, à Vevey et au Château de Chillon, sur le lac Léman, puis à Rome, dont une belle scène au crépuscule dans le Colisée. Une œuvre surprenante, à redécouvrir.
Nickelodeon (1976)

Après l’échec d’Enfin l’amour ! (voir ci-contre), Bogdanovich se voit proposer un scénario sur les débuts du cinéma muet, qu’il décide immédiatement de réécrire entièrement – entamant un bras-de-fer durable avec la production. Son récit s’inspire de ce que lui ont inspiré les « old timers » d’Hollywood, en premier lieu Walsh et Ford, qu’il a passionnément interviewés : ce sera donc le passage du Nickelodeon, les courts-métrages des premiers temps qu’on voyait pour un « nickel » (5 cents) au cinéma comme langage et art à part entière : le film s’achève ainsi sur l’avant-première de Naissance d’une nation, qui, à l’époque de Bogdanovich, n’avait pas encore été mis au ban de l’histoire du cinéma – il y a d’ailleurs un passage très drôle où Burt Reynolds est engagé pour jouer sur une scène de théâtre un membre du Klu Klux Klan.
Nickelodeon raconte, assez joliment, comment on pouvait devenir, vers 1910, cinéaste (Ryan O’Neal) et star (Burt Reynolds) par hasard, en découvrant sur le tas la puissance du septième art, à la fois en termes de création et de notoriété. Ce propos, sérieux et sensible, Bogdanovich a peut-être le tort de le traiter en comédie burlesque mais le film vaut mieux que sa réputation, avec certains passages forcés (une bagarre qui veut rimer très fort avec celle de L’Homme tranquille, de Ford), d’autres vraiment très gracieux (tout ce qui a trait aux tournages « primitifs » et au personnage joué par Tatum O’Neal). La Columbia s’immisça dans le casting, refusant les noms d’Orson Welles (remplacé par Brian Keith) et de Cybill Shepherd (remplacée par l’inconnue Jane Hitchcock), puis exigea que le film sorte en version couleurs. Bogdanovich trouvait à juste titre que le noir et blanc correspondait plus au sujet et dut attendre plus de trente ans pour faire exister le film dont il rêvait en dvd.
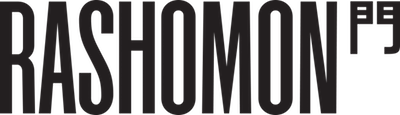





Leave A Comment