
LE PLUS OUBLIÉ DES FILMS DE BOGDANOVICH ? UN MUSICAL INSPIRÉ PAR COLE PORTER, MASSACRÉ À SA SORTIE. ET POURTANT SI SAVOUREUX…
« La comédie musicale mort-née de Peter Bogdanovich : un pastiche inlassablement insipide des chassé-croisées romantiques Art Déco des années 30 » (Pauline Kael dans The New Yorker), « quand elles dansent, les stars ont l’air d’essayer d’éteindre un feu de camp » (Jay Cocks dans Time – j’adore cette idée). Les critiques que Peter Bogdanovich encaisse à la sortie américaine, au printemps 1975, de Enfin l’amour (At long last love) seraient de celles qui pousseraient n’importe quel cinéaste à l’exil ou au choix d’une autre profession. Pas Bogdanovich, toujours assez sûr de son fait, qui accusa d’abord la Fox d’avoir sorti le film n’importe comment, puis accepta quand même (et ensuite regretta) de rédiger une sorte de lettre ouverte d’excuses diffusée dans la presse – si quelqu’un la trouve sur le net, je suis preneur. Néanmoins, le film disparut rapidement des radars.
Son idée de départ est simple : prendre un florilège des chansons du génial Cole Porter (1894 – 1964) et broder autour d’elles une vague intrigue à la façon des comédies musicales de l’âge d’or – l’âge d’or du noir et blanc, s’entend -, soit un entrelacs de marivaudages dans la haute société new yorkaise. Casse-gueule ? Dans le Positif de la sortie française, le regretté Michel Perez qui met Cole Porter assez haut (« d’inépuisables fontaines de jouvence, du nitrite d’amyle capable de galvaniser les ardeurs les plus défaillantes ») y voit le syndrome « des gens pas trop inspirés qui se sont dit avec une charmante naïveté qu’on pourrait faire des «musicals» merveilleux avec [ces chansons], rien qu’en les alignant les unes derrière les autres, oubliant qu’elles proviennent à 80% de musicals qui étaient déjà merveilleux en leur temps ».
Qu’importe ! C’est Cybill Shepherd, la compagne de Bogdanovich, qui lui a offert une anthologie des meilleurs textes de Porter et le cinéaste, comme tout le monde, a été séduit par l’inventivité des « lyrics », leur merveilleuse économie et leur humour brillant mis en valeur par des mélodies à la fois simplissimes et géniales de rythme et de mélancolie. Cole Porter, c’est vraiment « l’air de rien », tout le temps – l’art mineur qui n’en est pas absolument pas un, l’élégance avant tout, fût-ce celle du désespoir.
Capter cet « air de rien », l’offrir à des personnages comme un programme de vie, c’est le projet délicieux d’Enfin l’amour. Bien sûr, trois des quatre comédiens (Cybill Shepherd, Burt Reynolds et l’Italien Duilio del Prete, dont Bogdanovich s’est entiché pour de mystérieuses raisons) ne sont pas des danseurs et chanteurs émérites : mais d’une certaine façon, cet amateurisme revendiqué – le film est chanté en « live » – est justement ce qui l’empêche d’être juste un hommage, un pastiche fignolé avec maniérisme.
Disons que le film fait joliment faire de jolies choses à de bien jolies personnes, et j’ai du mal à ne pas le trouver savoureux, notamment grâce à la pétulance de la merveilleuse Madeline Kahn – la seule showgirl professionnelle du cast. Madeline Kahn (une habituée des films de Mel Brooks) joue une chanteuse de Broadway dont le numéro m’amuse beaucoup : « Find me a primitive man » – trouve-moi un homme primitif – demande-t-elle devant des Néanderthaliens qui se dandinent.
La chanson est issue d’une comédie musicale oubliée de Cole Porter (et à mon avis, pas aussi merveilleuse que Michel Pérez l’imaginait), Fifty million frenchmen, qui se déroule à Paris et raconte comment un milliardaire fait le pari de séduire une jeune femme sans jamais user de sa richesse. On y trouve donc cet hymne drolatique à la sauvagerie amoureuse : « I could be the personal slave / of someone just out of a cave » (« je pourrais être l’esclave / d’un type sortant d’une caverne »). Dernier couplet en français et assez explicite (absent de Enfin l’amour) : « j’ai besoin d’un bel animal / pour chauffer mon chauffage central ». Lyrics complets ici.
Fifty million frenchmen, malgré la présence d’un vrai tube de Porter, You do something to me, a été portée à l’écran en 1931 par Lloyd Bacon mais… sans musique. Je crois comprendre que les chansons ont été retirées du film parce que pendant quelques mois, aux balbutiements du parlant, le public, croyait-on, ne voulait pas de comédie musicale. Étrange… Ce qui fait que trois ans plus tard, le musical a droit à un digest de vingt minutes, un court-métrage Vitaphone notamment joué par le jeune Bob Hope, sous le titre Paree Paree (le gai Pareee…), chansons incluses, cette fois.
C’est une nommée Billie Leonard, venue de Broadway, qui joue la touriste américaine délurée en quête du Paris des bas-fonds (Bob Hope la traînera dans un café où des apaches se battent au couteau) et d’un beau mâle. La choré à côté d’elle n’a rien à voir avec la chanson, jusqu’à l’apparition des hommes préhistoriques. Le flop de Enfin l’amour, suivi par celui de Nickelodeon, n’a pas ouvert une période heureuse pour Bogdanovich ; mais on peut penser qu’en préparant le film et en visionnant, sans doute avec Cybill Shepherd à ses côtés, une tonne de « musicals » signé Cole Porter, y compris ces drôles de raretés, le cinéaste avait passé quelques moments d’archéologie hollywoodienne bien savoureux.
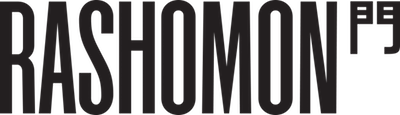





Leave A Comment