Pour sa neuvième édition, le PIFFF, ou Paris International Fantastic Film Festival, s’ouvre par Color out of space, de Richard Stanley, d’après H. P. Lovecraft, et offre jusqu’au 17 décembre au Max Linder à Paris, une orgie de films venus du monde entier, quasiment inconnus et probablement bien barrés… Le délégué général du festival, Cyril Despontin, nous présente cette édition, et, plus largement, nous raconte son goût pour le genre.

Comment est né le PIFFF ?
A l’été 2011, j’ai proposé de faire ce festival avec Mad Movies. On s’est décidés très vite puisque la première édition a eu lieu dès novembre de la même année. Historiquement, le grand Festival de Cinéma Fantastique était celui qui se tenait au Grand Rex, appuyé sur l’Écran Fantastique. Il s’est arrêté en 1989. Paris n’a plus de festival spécialisé alors qu’il y en a à Bruxelles, Neuchâtel, Porto, Sitges, etc. L’Étrange Festival s’intéresse à des films bizarres, disons. On voulait une programmation moins pointue, plus grand public.
Je suis Lyonnais d’origine. J’organise d’ailleurs à Lyon le festival Hallucination collectives qui a lieu chaque week-end de Pâques. Je vais avoir 40 ans. Je suis cinéphile au sens large, mais j’ai toujours eu une appétence pour le fantastique. Je me suis formé au genre via les vidéo clubs et Canal+, et en lisant Mad Movies. Ma culture fantastique a explosé à l’aube des années 2000 grâce aux forums de cinéma sur internet. Jusque-là, en province, et même à Lyon qui est une grande ville, c’était compliqué de rencontrer d’autres fans. Et dès qu’on échange avec des alter ego passionnés, on n’est plus un autodidacte, on partage des connaissances. Grâce à DeVilDead, par exemple, à l’époque le seul forum francophone sur le fantastique, j’ai découvert le cinéma d’horreur italien, Lucio Fulci, Dario Argento. J’ai créé le forum ZoneBis. Il y a aussi le forum de Mad Movies, et puis DVDClassik, plus pointu sur les films de patrimoine.
Du temps du festival du Rex, le fantastique était un genre marginalisé, aujourd’hui il est devenu mainstream. Comment expliquer cette mutation ?
C’est vrai qu’il n’y a qu’à voir les festivals « A » qui passent de plus en plus des films de genre… Et côté business, les plus gros films qui cartonnent restent ce que j’appelle des « films de l’imaginaire », comme les Marvel. Je pense que c’est beaucoup une histoire de génération : les décideurs d’aujourd’hui ont été nourris pendant leur adolescence au cinéma de genre via les VHS. Les séries ont aussi contribué à démocratiser le genre mais X-files était déjà un carton dans les années 90 !
Tous les gens de l’industrie sont d’accord : un film d’horreur, ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter beaucoup plus que son budget. Mais le risque existe. D’ailleurs, sur les deux cent cinquante films qu’on a proposés lors des huit éditions précédentes, il n’y en a qu’une cinquantaine qui sont sortis en salles ou en vod, tous les autres ont disparu des radars.
L’imaginaire plaît mais le cinéma fantastique n’est toujours pas perçu comme du cinéma d’auteur sérieux. Il y a moins de condescendance qu’à une époque, mais il y en a toujours. Nous, on aimait que le fantastique soit un peu subversif. Dans les films qui marchent, ce n’est pas tout à fait ça.
Comment le paysage du genre a-t-il évolué, dernièrement ?
Au début de la décennie, on a vu beaucoup de films à sketch, comme V/H/S ou ABCs of Death. Des films très faciles à produire : on donne une petite enveloppe de 3000 dollars à plusieurs réalisateurs de différentes nationalités qui font leur sketch dans leur coin. A l’arrivée, le film coûte X fois 3000 dollars, et peut rapporter beaucoup plus. Le producteur néo-zélandais Ant Timpson a bâti sa carrière là-dessus. Il vient de tourner son premier film comme réalisateur, Come to Daddy, avec Elijah Wood
Il y a aussi ce qu’on appelle le « elevated genre », avec notamment les films d’Ari Aster (Hérédité, Midsommar) ou Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse). Je ne suis pas très fan. J’aime bien le début d’Hérédité mais c’est du genre fait avec des pincettes, comme si c’était un peu sale, comme si ces cinéastes se devaient d’affirmer qu’ils font quand même du grand cinéma ! Je sur-interprète peut-être. Mais il y a toujours eu des auteurs dans le cinéma fantastique, comme David Cronenberg. Disons que le marketing a pris le dessus et a « brandé » ça. Mais comme on dit à Mad Movies, le genre n’a pas vocation à être « bien élevé ».
L’échec du Suspiria de Luca Guadagnino est un symbole de cette évolution ?
C’est un bon exemple, même si tout n’est pas à jeter dans ce remake. Le plan d’ouverture résume la différence entre les deux films : chez Argento, quand Jessica Harper arrive de l’aéroport, c’est baroque, lumineux, avec une musique très opératique. Chez Guadagnino, c’est terne, un Berlin monochrome, avec une musique certes très belle de Thom Yorke, mais très posée.
Vos films fantastiques préférés de la décennie ?
Le film qui m’a le plus impressionné, c’est The Strangers, du Coréen Na Hong-Jin. C’est le seul film qui m’ait fait vraiment peur en dix ans. Je connais bien les mécanismes, j’y suis moins sensible qu’un spectateur moins expérimenté, mais là un sentiment indicible de peur ne m’a pas quitté. Je citerai aussi Mad Max : Fury road, qui est un film-somme. J’espère que ce n’est pas de « l’elevated genre » !

Quelle est la couleur de l’édition 2019 ?
Je ne crois pas aux thématiques de programmation que l’on décrypte a posteriori. Nous, on ne s’interdit rien, on voit 600 films, et ceux qui nous plaisent, on les montre ! Il se trouve qu’il y a beaucoup de pays représentés. Et des pays dont on voit peu de films en France. Je pense par exemple au film indien Jallikattu, qui est complètement fou. C’est du cinéma pur avec un montage hallucinant, des plans qui vont rester dans les rétines des gens. A part nous qui va le montrer ? Ceux qui auront la curiosité de voir un film fantastique indien vont découvrir un cinéma brutal, viscéral, l’histoire d’un buffle qui attaque un village et du village qui attaque le buffle ! Une ambiance de film d’horreur sans que c’en soit un à proprement parler. Dans la foulée, c’est samedi soir, on enchaîne avec Bullets of justice, un film kazakh méchant, avec un humour très corrosif à la South Park. Il y a aussi des films indonésiens, finlandais, irlandais, italien, etc.
Les plateformes de S-Vod ont besoin de films fantastiques. Elles vous les proposent ?
On se parle ! Trois films Netflix auraient pu nous intéresser : La Fracture, de Brad Anderson, In the shadow of the moon, de Jim Mickle et Dans les hautes herbes, de Vincenzo Natali. Mais ils sont sortis avant le festival. J’aimais bien aussi un film espagnol, La Plateforme, qui est passé à Toronto et Sitges. Mais Netflix l’a acheté et le vendeur ne sait pas s’il a encore le droit de le faire tourner en festival !
Ce ne serait pas intéressant de montrer ces films sur grand écran ?
On n’a pas assez de séances pour montrer des films que les gens peuvent voir ailleurs… C’est pour cela qu’on ne programme pas non plus de master-class, parce qu’on veut montrer plein de films ! Je déteste les festivals où les films se chevauchent, je ne veux pas qu’on m’oblige à faire des choix.
Il y avait un film Netflix que j’aurais pu montrer il y a deux ans avant qu’il soit mis en ligne : Le Rituel, de David Bruckner. J’aime beaucoup le travail de ce cinéaste qui signait régulièrement les meilleurs sketches de ces « films-omnibus » dont j’ai parlé. Pourquoi ne pas le montrer dans quelques années, quand il aura disparu des radars ? Il sera toujours aussi bien !
Dans nos séances « rétro », on passe des films de ce que j’appelle la « zone grise ». Pas assez anciens pour être montrés en Cinémathèque, trop vieux pour être dans des festivals. L’an passé, on avait montré Vorace, d’Antonia Bird, cette année Emprise, de Bill Paxton. Et puis Battle royale, et en 35 mm : je me dis que les jeunes qui ont vu Hunger games, n’ont peut-être jamais vu Battle royale et en tout cas certainement pas en salles !
Comment le PIFFF peut-il évoluer ?
Il faudrait pouvoir professionnaliser les équipes. Quand j’annonce notre budget, qui est entre vingt et vingt-cinq mille euros, les gens nous regardent, étonnés : vous arrivez à faire autant avec si peu ? Ça doit être cinq fois moins que le Festival de Gérardmer, par exemple. Eh bien, on est bénévoles ! Il faudrait salarier des gens, pour la recherche de financements, pour le visionnage des films, etc.
On arrive à faire environ dix mille entrées par édition, ce qui est un bon taux de remplissage. On partage la recette avec le Max Linder. On a quelques sponsors, comme Ciné+ ou FilmoTV, et une aide de la Mairie de Paris pour la première année. Et on installe une petite boutique éphémère. Idéalement, il faudrait un gros sponsor privé, intéressé par un public jeune. On avait contacté M&M’s. Ils nous avaient répondu : « on peut vous filer des M&M’s gratuits ». Ça ne nous servait à rien, il y a déjà la confiserie du cinéma…
Propos recueillis par Aurélien Ferenczi
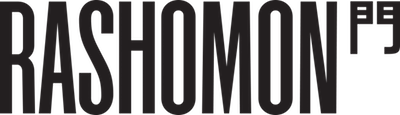





Leave A Comment