
ESSORAGE D’UN PROCÉDÉ NARRATIF : QUAND LE CINÉMA OU LA SÉRIE FANTASTIQUE ABUSE DES SCÈNES DE RÊVE, AU POINT DE LES RENDRE INOPÉRANTES….
Vous n’en avez pas marre, vous, des scènes de rêve ? Dans Archive 81, par exemple la série Netflix plus maligne que réellement convaincante coproduite par James Wan, le héros, Dan Turner, n’arrête pas de se réveiller : une fois c’est la bouche pleine de moisissure, une autre fois il n’est pas dans le lit où il devrait être, une autre fois encore, je me souviens mal, sûrement était-il transformé en K7 Betamax – ou un truc comme ça…
Terrifiant ? Pas longtemps, puisque la scène s’interrompt illico et que Dan se réveille à nouveau, cette fois dans son lit, eh oui c’était un rêve… Dans le cinéma (ou la série) fantastique, aujourd’hui, non seulement le héros rêve des trucs affreux, mais il rêve qu’il se réveille, avant de vivre ce réveil « en vrai »… Bientôt (ça a dû déjà arriver), le deuxième réveil sera aussi un rêve, etc. Moi, perso, je ne rêve jamais que je me réveille…

Le procédé a été payant : il permet de placer une scène spectaculaire, voire effrayante, avant que la logique du récit ne le recommande vraiment ; de montrer le trouble grandissant du personnage principal ; de mettre les spectateurs sur leur garde : vous êtes bien devant un film d’horreur. Sauf qu’à force d’y être, sur nos gardes, on glisse à son voisin : « Tu vas voir, c’est un rêve… » Marge d’erreur : 10%. Le procédé, surexploité, ne marche plus, il s’est usé.
Des scènes de réveil qui se révèlent être des scènes de rêve, il y en a un bon paquet dans Nanny, premier film d’une cinéaste américaine originaire de Sierra Leone, Nikyatu Jusu, qui vient de remporter la compétition nationale du Festival de Sundance. Son héroïne, une jeune Sénégalaise qui a émigré à New York, s’occupe de la petite fille d’un couple visiblement à son aise, vu la taille de l’appart’. Elle attend de réunir assez d’argent pour faire venir son propre fils, Lamine. Et elle multiplie des rêves d’étouffement aquatique – dans son lit ou à la piscine, où, comprend-on, elle a fait un malaise. Les dangers que ces épisodes suggèrent concernent-ils la fillette dont elle a la garde ou son fils dont elle a de moins en moins de nouvelles ? Suspense (vaguement), le tout étant un peu gâché par la proximité de certains éléments (la mère odieuse, le père sympa) avec la série Apple Servant.
Bizarrement, ici, la lente intrusion du fantastique, mâtinée de divinités pan-africaines, dieu-araignée et déesse-sirène, brouille, voire gâche un récit qui construisait sobrement un beau personnage : Aicha, qui passe du temps avec d’autres migrants dans la même situation qu’elle, se bat contre l’arrogance de ses employeurs, se fait gentiment draguer par le concierge noir de l’immeuble de luxe, et qui bénéficie de la belle interprétation de la jeune Alana Diop.
Nanny – et ça ne m’étonne pas que le jury de Sundance l’ait récompensé – utilise de façon maladroite le fantastique pour traiter (mal) de sujets réels : le déracinement, la persistance des rapports coloniaux (mieux vaut être esclave ici que chez nous, dit en substance une des copines d’Aicha, au moins on est payées, et en dollars), etc. Le cinéma fantastique parle abondamment de nous et du monde dans lequel nous vivons, mais je préfère quand il le fait de façon souterraine, sans que jamais cette relation au réel vienne troubler le déroulement d’une fable horrifique ou surnaturelle.
Nanny fait partie d’une nouvelle catégorie de films, à l’image de Relic, de Natalie Erika James (sur la démence sénile et la fin de vie) où le fantastique masque mal le réalisme social à l’œuvre. C’est un additif destiné à rendre plus facile la commercialisation du film. Si les Dardenne bossaient pour Netflix, finiraient-ils leurs films façon Wes Craven ? Ici, le fantastique n’est que l’enrobage d’un « message » plutôt que l’expression dérangeante de la puissance de l’imaginaire. Pour les messages, privilégiez la poste, disait, je crois, Billy Wilder.
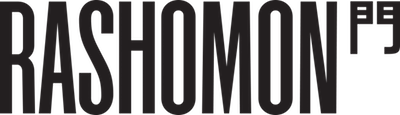





Vrai : les seuls rêves qui vaillent sont les nôtres à nous. À moins que le défi de Dylan (« I’ll let you be in my dreams if I can be in yours ») soit exaucé.