Arnaud Desplechin met en scène à la Comédie-Française Angels in America, document sur les années Sida et beau cadeau aux acteurs de la troupe.

Ceux qui sont trop jeunes ou qui n’étaient, comme moi, pas assez attentifs à l’actualité théâtrale des années 90 ont raté l’événement Angels in America. La pièce de Tony Kushner (né en 1956), lauréate du Prix Pulitzer, a été jouée dans son intégralité à Broadway (deux parties, près de sept heures de spectacle en tout) en 1993. En France, c’est Brigitte Jaques qui monte la première partie au Cloître des Carmes au Festival d’Avignon 1994, avant de présenter la totalité au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers deux ans plus tard.
C’est alors quasiment un texte d’actualité, ou en tout cas d’histoire immédiate : cette « fantaisie gay sur des thèmes nationaux », pour reprendre son sous-titre, entremêle le destin d’homosexuels à New York au milieu des années 80, dont deux atteints du sida. La pièce brasse large, inclut les victimes de la maladie à l’histoire des Etats-Unis, en prenant notamment comme personnage la figure authentique de Roy Cohn, avocat magouilleur qui fut le « dramaturge » du sinistre sénateur McCarthy, et refusa d’admettre qu’il mourait du sida, ayant toujours caché son homosexualité. Elle s’élargit même à l’histoire du monde, s’achevant sur une autre hécatombe annoncée, la catastrophe de Tchernobyl en 1986.
« Tony Kushner procède en mêlant la technique des sitcoms à l’idéologie des pièces didactiques de Brecht », écrivait justement Brigitte Salino il y a vingt-cinq ans. Arnaud Desplechin, pour sa deuxième mise en scène à la Comédie-Française, a respecté le souhait de l’auteur : plateau quasi-nu, accessoires réduits au minimum, projections en fond qui montrent des vues de New York, gratte-ciel de nuit, Central Park, etc. L’inverse du décor imposant, mi-protection, mi-prison, de son premier spectacle au Français, Un père, de Strindberg. Et comme dans une série aux multiples développements, ça va vite, très vite, pour dire les destins de Joe, le juriste mormon qui cache, lui aussi, son goût pour les hommes, celui de Louis, incapable de supporter la maladie de son compagnon, Prior, etc. Pour montrer surtout comment le destin des personnages peu à peu s’entrecroisent.
L’histoire de la pièce, son inscription dans son époque, a peut-être plus d’importance que la pièce elle-même, dont l’écriture n’atteint jamais les fulgurances d’un Koltès ou d’un Lagarce. Mais, tout de même, Angels in America est une belle machine à jouer où la troupe de la Comédie-Française, sûre de son fait, trouve de quoi se nourrir. La première scène offre ainsi un rôle inattendu de rabbin à Dominique Blanc, auteur d’une prestation majuscule : elle sera ensuite notamment mère mormone et fantôme d’Ethel Rosenberg, cette New-Yorkaise communique que Roy Cohn, envoya, avec son mari Julius, sur la chaise électrique. Belle prestation, aussi, de Jeremy Lopez dans le rôle de Louis, honteux de sa propre peur face à la maladie.
Mais la figure la plus tonitruante, à tous les sens du terme, reste celle de l’avocat maccarthyste (puis reaganien) : Roy Cohn est interprété par Al Pacino dans la version télé d’Angels in America, signée Mike Nichols. En France, Jean-Yves Chatelais puis Daniel Martin s’emparèrent successivement du rôle. Salle Richelieu, c’est Michel Vuillermoz qui s’amuse à donner une dimension méphistophélique – il faut bien un peu de diable puisque des anges, réels ou rêvés, viennent visiter les personnages – à ce salaud flamboyant. Lors d’une scène dans un bar new-yorkais, décor à la Hopper, où Cohn tente de corrompre le jeune Joe (Christophe Montenez), Desplechin trouve des accents scorsésiens. On est bien au cœur des mythologies américaines.
Aurélien Ferenczi
Comédie-Française, salle Richelieu, jusqu’au 27 mars.
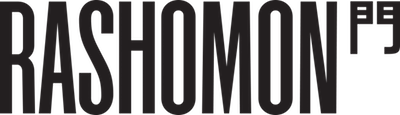





Leave A Comment